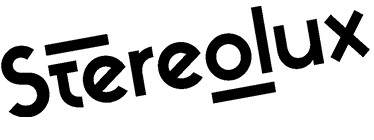J’AI TESTÉ : IN.VISIBLE(S) - L'EXPOSITION ET LES INSTALLATIONS
Adeline Praud – Nous, les invisibles ?!
L’exposition-témoignage photographique affichée sur les murs du hall de Stereolux ne montre pas de manière détachée un public invisibilisé : elle donne la parole et la fixe par le texte. Les quatorze portraits affichés répondent à autant de contextes personnels différents, rassemblés par leur effacement aux yeux de la société — un moyen dévoyé pour ne pas avoir à dire « à nos yeux ». En rendant visible une diversité de parcours — échappé·e·s à la dictature, à la précarité économique et sanitaire, à un milieu abusif, à une situation psychologique fragile…—, l’intention d’éclater l’uniformité appliquée d’usuelle (« elles/eux », « les personnes précaires », « les migrant·e·s », etc.) est réalisée. L’approche photographique à tendance naturaliste — à peu de chose près, peu mise en scène et humble dans la technique — soutient le propos mis en avant.

Si le format n’a rien de révolutionnaire, le message au moins est clair. Mais ce qui est intéressant dans les discours présentés c’est que les personnes interrogées ne cherchent pas, ni ne revendiquent de devenir visibles. A chaque fois il s’agit d’accéder à une forme de liberté jusque-là inexistante, d’accéder à une réalisation personnelle. Et leur invisibilité ne semble être qu’un symptôme d’une société qui, sans chercher à la produire, y accède en choisissant de ne pas voir les mécanismes qui y amènent — c’est toujours le meilleur moyen de se déresponsabiliser. Ce qui d’ailleurs entretient des comportements tenaces qu’Adeline Praud décrit dans son introduction : méconnaissance, absence et déni de reconnaissance, jusqu’au mépris. À bien des égards, cette attitude désinvolte imprègne notre environnement insidieusement : l’ignorance active a un coût, ici social, ailleurs écologique. Le mal reste le même.
On aurait presque aimé un espace dédié pour ces portraits, ou bien qu’ils soient disposés à hauteur d’yeux, pourquoi pas arrimés au sol. Les photographies suspendues font partie des murs et la plupart des gens n’étant absolument pas attentifs à leur environnement (vous pourrez toujours essayer de vous convaincre de l’inverse), manquent assez facilement l’exposition. Ou par le petit effort requis, s’en détachent rapidement — « ah tiens, encore des affiches ». À moins que cela fonctionne comme une ultime mise en abîme…
Martin Hesselmeier & Andreas Muxel (plasticiens) – The Weight of Light
The Weight of Light s’inscrit dans la continuité d’expérimentations abordées par Diane Gouard au travers de sa mini-conférence en proposant une mise en forme tangible de l’élément invisible qu’est la lumière.
Le dispositif est relativement minimal car simplement composé de deux grands tubes LED de forme sinusoïdale d’une douzaine de mètres de long et d’environ deux mètres de haut légèrement espacés l’un de l’autre. Les courbes se complètent symétriquement une fois vues de face — les points hauts de l’une correspondent aux points bas de l’autre. La vue de côté est elle aussi significative dans le sens où elle profite d’un effet de perspective intriguant lié à la longueur importante de l’installation.

Le procédé en place répond à l’efficacité sculpturale de l’ensemble : des points de lumière parcourent chaque courbe dans un jeu de balancier. Ces sortes de feu follets transmettent, au-delà d’un poids, une qualité liquide à la lumière : les points en déplacement laissent des traces. En s’approchant on profite de l’apparition de chaque diode, unité charnière dans un processus de relais d’énergie. Une lumière de surcroit blanche qui, dans le propos avancé, n’aurait pas grand intérêt à être travaillée dans sa colorimétrie sans devenir distrayante.
Les allers-retours de la substance lumineuse sont accompagnés de sonorités synthétiques basiques dont le rythme et l’intensité sont produits par la vélocité du mouvement, pas très loin d’un sabre laser de vous-savez-quelle-franchise.
Bien qu’hypnotisant et revendiquant sans soucis sa pureté formelle, The Weight of Light souffre malgré tout quelque peu de l’espace exigu dans lequel le dispositif se trouve, celui-ci ne permettant pas d’obtenir un recul suffisant pour apprécier l’objet cinétique dans sa globalité sans avoir à tourner la tête. C’est juré, malgré ce qui peut en paraître, il ne s’agit pas de pure paresse !
Pierre Guflet (artiste multimédia, co-fondateur du collectif Visualsystem) & Laurent Mareschal (activiste et touche-à-tout de la scène artistique nantaise) – Moi, centre du monde V1
Seule installation proposant une interaction directe, Moi centre du monde Version 1 assoit un·e utilisateur·rice unique au centre d’une série d’écrans disposés en cercle. Presque équidistants les uns des autres, chacun diffuse l’image d’une localisation se déplaçant géographiquement le long d’une courbe (la Terre étant sphérique pour celles et ceux qui ne remettent pas la réalité en question) dont le point de départ est … l’utilisateur·rice situé·e dans le hall de Stereolux. À l’aide d’une télécommande, on choisit de rentrer une valeur pour se déplacer simultanément dans six directions — au plus simple, il suffit d’imaginer un Google Street View puissance 6, libéré des contraintes physiques données par les constructions humaines : on ne se déplace plus sur des chemins acceptés où serait passée une Google Street Car mais sur des trajectoires parfaites. On prend la voie du vol d’oiseau.

Difficile de choisir où aller tant la notion de distance perd son caractère concret. Du moins dès qu’on passe plusieurs centaines de kilomètres et que l’on se voit sur près de la moitié des écrans au milieu de « nulle part » (à moins que ce soit partout). Toutefois, un certain nombre de distances remarquables ont été imprimées sur papier, et libre à qui veut d’aller visiter ces lieux disséminés presque forcément au hasard. Une expédition dans l’arctique, un village caché dans la jungle, un bord de plage sur la côte Ouest des Etats-Unis … S’il y en a autour d’une cinquantaine, aucune valeur ne propose un jackpot parfait de six destinations surprenantes. Mais c’est aussi ce qui rend le dispositif intéressant puisque selon la distance parcourue, coexistent du « tout » et du « rien ».
L’essentiel de Moi, centre du Monde V1 réside dans son titre : un work in progress aux possibilités qui font rêver. Si le projet tel qu’il est proposé nous laisse clairement sur notre faim par la simplicité de l’installation, on imagine tout à fait ce que pourrait offrir des versions « supérieures ». Un passage par la réalité augmentée et/ou virtuelle où chaque lieu nous offrirait une ambiance complète selon l’endroit où notre regard se porte, permettrait de fournir une immersion accrue et développerait sans aucun doute l’idée d’une projection quasi spirituelle à même d’enrichir notre perception par la fragmentation. Passer d’un silence polaire, au brouhaha urbain, à une mer déchainée ? Oui, s’il vous plait. Il y aussi un côté science-fiction alléchant par la simplicité du moyen de déplacement lié à la télécommande servant à rentrer les distances — on n’est pas loin d’une machine à voyager dans les dimensions à la Sliders, les mondes parallèles. Le choix des directions (ici 25°, 70°, 129°, 163.16°, 225°, et 300.5°) est bien évidemment largement adaptable à chaque « centre » où le projet pourrait venir se poser. L’infinité de distances que chacun·e pourraient choisir, couplée à l’infinité de « centres » où le dispositif pourrait se poser, nous laisse effectivement penser que la proposition est bien « tout sauf égocentrique ».
Voir aussi

J’ai testé : In.Visible(s) - Soirée de lancement / Vernissage

J’AI TESTÉ : IN.VISIBLE(S) - LES ATELIERS / WORKSHOPS ET MINICONFÉRENCES