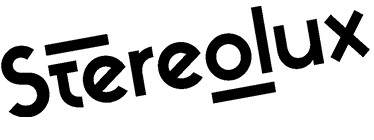Villes intelligentes (en mode bêta)
Le concept de “ville intelligente” séduit, mais gare à la tentation de villes lissées par le numérique et dénuées de tout chaos... / Philippe Gargov
“Smart” par-ci, “smart” par-là : ces dernières années, la ville intelligente aura conquis l’espace public, au sens littéral comme au figuré. Il ne passe pas une journée sans que l’on ne parle de la smart city dans les médias généralistes ou spécialisés, ni sans qu’une collectivité n’impulse un projet de “ville intelligente” à grands renforts de com’ et de partenariats public/privé.
Loin de nous l’idée de cracher sur la smart city. Les principes théoriques et pratiques qui la définissent se justifient largement au prisme des réalités contemporaines. La ville est en effet loin d’être parfaite, et s’il est possible de corriger certaines de ses dérives (congestion, pollution, gaspillage, etc.) grâce au numérique, pourquoi s’en priver ? Le problème vient en réalité de ce que ses promoteurs entendent par “corriger” : dans leur bouche, on peut craindre de comprendre “lisser”, voire “policer”.
Le Quartier des spectacles (Montréal)
C’est là une chimère presque aussi vieille que le numérique lui-même : la ville intelligente, qui n’est finalement que le dernier avatar des utopies urbaines, serait une ville parfaite, sans erreurs. C’est oublier que la ville est nécessairement chaotique — c’est précisément ce qui fait tout son sel. Le journaliste Xavier de la Porte le résumait parfaitement à l’antenne de France Culture dans un plaidoyer en faveur d’une « ville intelligente qui soit aussi ignorante, affective et idiote ». On ne pourrait trouver mieux que ces trois termes, qui méritent tout de même une explication.
Ignorante, d’abord : cela implique d’admettre que le numérique n’est pas omniscient, contrairement à l’idée que l’on s’en fait. Dans cette perspective, si intelligente soit-elle, la ville de demain ne pourra pas répondre de toutes ses bêtises. Pour pallier ces lacunes, une solution : faire appel aux premiers concernés, soit les citadins eux-mêmes, en les intégrant dans les processus de conception-production des services qui régiront leurs vies futures.
Affective, ensuite, et cela découle directement du point précédent. Il manque aujourd’hui à la smart city cette envie de stimuler des interactions sensibles, sensitives, émotionnelles avec et entre les citadins. Le numérique n’est certes pas indispensable pour ça, mais il en a les moyens. Dans un contexte où les collectivités s’équipent d’un barda de capteurs, réseaux et systèmes en tous genres, pourquoi ne pas en profiter pour y saupoudrer ce qu’il faut de plaisir et d’irrationnel ?
Idiote, enfin et surtout : la ville intelligente doit assumer le fait qu’elle se peut se tromper, échouer, se vautrer lamentablement. Après tout, nul ne sait de quoi demain sera vraiment fait. Mais ceci suppose une chose fondamentale : dépenser des millions, voire des milliards d’euros d’investissements publics et privés dans lesmart, c’est prendre un risque inconsidéré et faire peser la menace d’une lourde épée de Damoclès sur la tête de nos collectivités aux pieds d’argile.
Ce triptyque sémantique appelle donc un changement de paradigme plutôt qu’un renversement de la ville intelligente dans son ensemble. De tels préceptes une fois posés, comment les concrétiser ? L’enjeu est logiquement plus complexe à formuler, mais beaucoup trop nécessaire pour qu’on se laisse submerger. De nombreux exemples existent de fait aujourd’hui, qu’ils soient issus de micro-initiatives ou de plus ambitieux projets, qui tous tentent de matérialiser d’autres horizons pour l’intelligence urbaine.
Les exemples ci-contre témoignent des horizons qui s’ouvrent quand on accepte l’idée d’une ville en mode bêta. Lentement mais sûrement, celleci fait d’ailleurs son petit bonhomme de chemin dans la tête de quelques décideurs, qui comprennent bien que leurs projets ne seront jamais acceptés comme tels. Car la réalité tient à un constat bête et méchant : le citadin lambda se fout que sa ville fonctionne “un peu mieux” ou gaspille “un peu moins”.

Le projet paraSITE de Michael Rakowitz
Cessons donc de le submerger d’indicateurs de performance qui pèsent si peu pour son quotidien. Et laissons plutôt les habitants s’amuser avec les technologies numériques et trouver les utilisations qui leur correspondent. Que celles-ci soient utiles ou bien ludiques, perfectibles ou complètement débiles, ne nous regarde finalement pas.
PARTAGES : LA VILLE EN PEER-TO-PEER
Parmi les sujets les plus évidents, les partages se révèlent un champs d’innovation particulièrement performant, désormais démocratisés grâce au partage de véhicules (autopartage / covoiturage) et d’appartements (sur le modèle d’Airbnb). En s’appuyant sur des réseaux sociaux — dédiés ou non —, les citadins peuvent aussi mettre en commun leurs machines à laver 1 ou le contenu non consommé de leurs frigos 2, et chacun y trouve son compte.
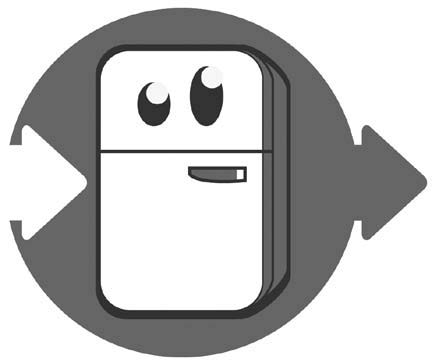
1 www.lamachineduvoisin.fr
2 www.partagetonfrigo.fr
HACKING URBAINS : LA VILLE EN DIY
C’est l’un des termes fondamentaux de la ville en mode bêta. Sans entrer dans le détail de ses turpitudes sémantiques, le hacking désigne le détournement de fonction que certains “hacktivistes” font subir aux infrastructures urbaines (mobilier, lampadaires, panneaux communicants, etc.). Plus que le numérique, c’est ici la culture de la bidouille et du piratage qui fait tout le sel de ces initiatives. Preuve — peut-être — de leur intelligence, des publicitaires s’en inspirent directement, à l’instar de McDonalds qui “pirate” les panneaux d’information en gare de Varsovie pour écouler du burger...
PARASITAGES ÉNERGÉTIQUES : BRAQUAGE DE VILLE
Toujours plus loin dans le détournement, on trouve aussi le parasitage. Ou comment certains équipements, créés par des citadins et associations, viennent se greffer à l’existant. On pensera par exemple aux microturbines du collectif Energy Parasite 1, qui viennent produire de l’énergie le long d’escalators ou à flanc de tramway. Plus corrosif, le projet paraSITE de Michael Rakowitz 2 vient directement récupérer l’énergie des chaufferies urbaines pour alimenter des abris SDF.
1 www.energyparasites.net
2 www.michaelrakowitz.com/projects/parasite
CROWDFUNDING : LA VILLE COFINANCÉE

Difficile de ne pas envisager une application à la ville des préceptes du financement participatif. Le sujet est en vogue depuis quelque temps, porté par de sémillants projets, tels que ce parc new-yorkais...souterrain 1. L’idée est séduisante, du moins sur le papier. Restent quelques interrogations, presque philosophiques : est-il vraiment justifié de faire payer les citadins pour un projet urbain, même si c’est pour qu’il leur ressemble vraiment ? C’est là la principale limite d’une ville plus proche de ses habitants, qui cherche encore ses équilibres.
1 www.gizmodo.com/kickstarter-urbanism-why-building-a-park-takes-more-th-1203759880
Voir aussi

J'ai testé la journée "mobilier urbain"

Le "Renouveau du mobilier urbain connecté", c'était comment ?
LA VILLE S’INVENTE AU LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES DE STEREOLUX
Lieu d’émergence et d’expérimentation transdisciplinaire, le laboratoire s’attèle en 2014 aux nouveaux usages de la ville, du mobilier urbains interactif à des applications ludiques et créatives pour les environnements connectés. Les actions sont multiples : workshops, résidences et prototypes.